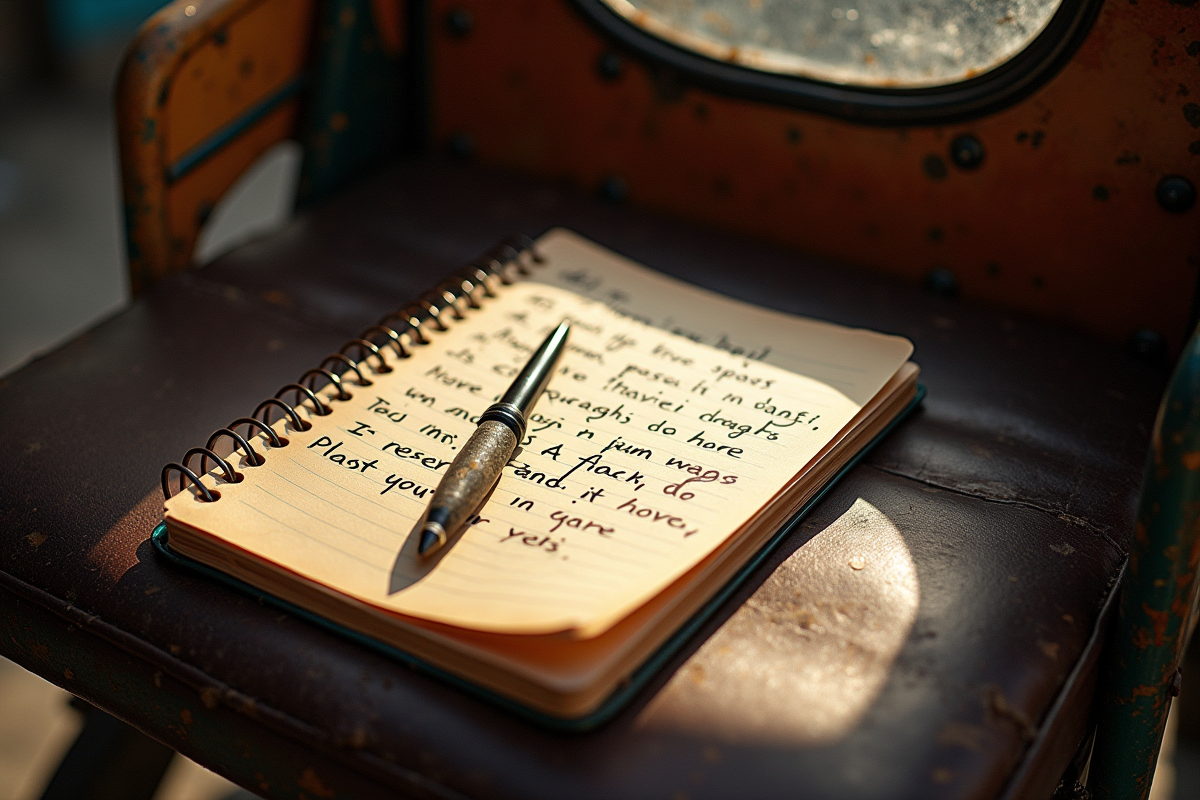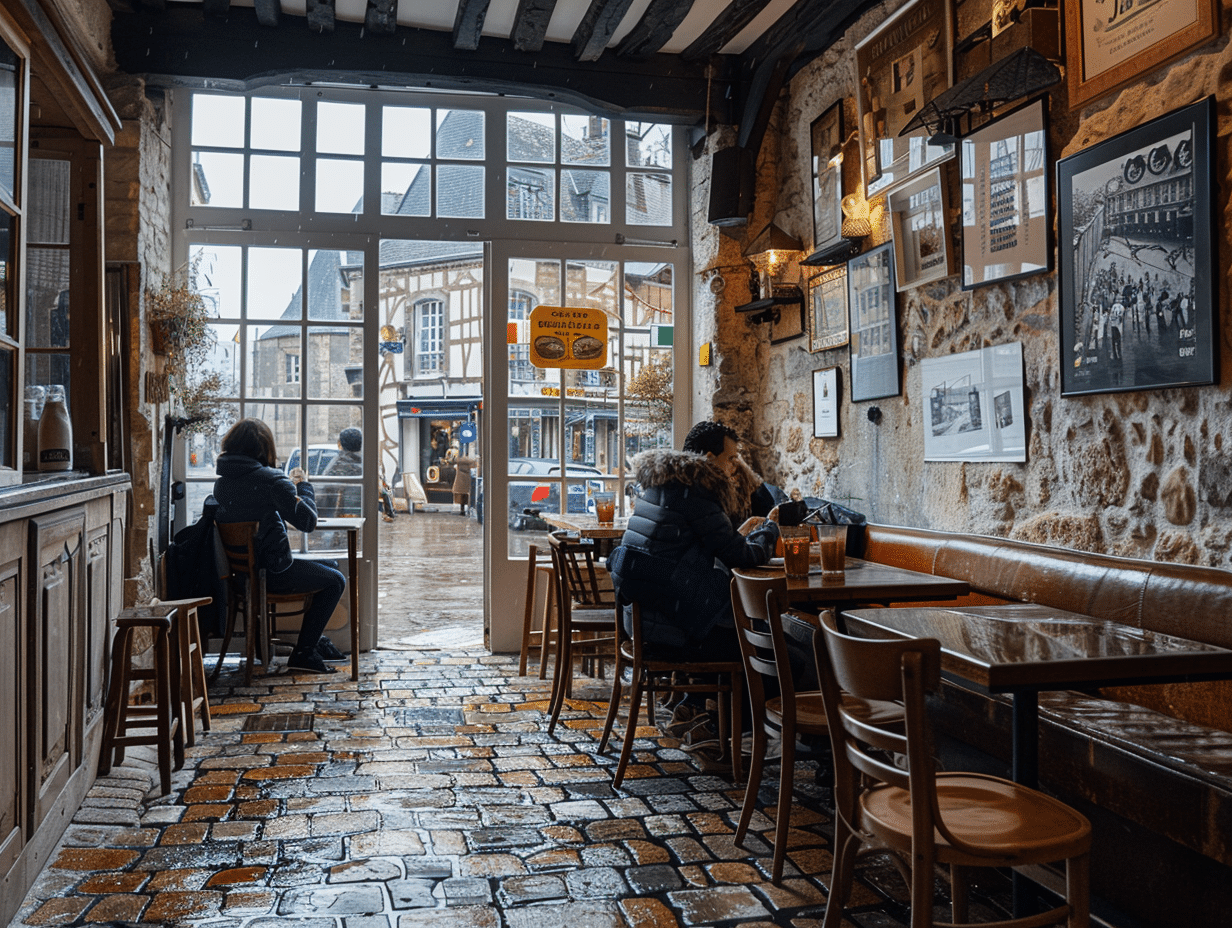Certaines expressions argotiques de Madagascar, issues des conversations entre tireurs de pousse-pousse et clients, figurent dans des dictionnaires spécialisés sans jamais être enseignées à l’école. Plusieurs mots utilisés dans ce contexte n’existent qu’à l’oral et demeurent incompris par la majorité des locuteurs malgaches.
En 2012, une commission linguistique a tenté de codifier ce langage sans parvenir à un consensus, tant ses usages varient d’une ville à l’autre. Quelques termes, pourtant, se sont exportés dans la vie quotidienne et se retrouvent parfois jusque dans les médias nationaux.
Aux origines de la langue du pousse-pousse : un curieux mélange de cultures
La langue du pousse-pousse n’est pas née d’un schéma préétabli, ni d’une volonté académique, mais d’une série de rencontres imprévues, de chocs culturels, et d’alliages linguistiques qui n’existent nulle part ailleurs. Paris, déjà laboratoire vivant au Moyen Âge, voit s’entrecroiser étudiants, voyageurs, artisans, marchands dans le tumulte du Quartier latin. Ici, le latin règne dans les amphithéâtres, mais la rue bruisse d’un argot populaire, reflet d’une cité cosmopolite.
Quand Robert de Sorbon fonde la Sorbonne en 1257, il ouvre ses portes à une jeunesse venue de toute l’Europe. Le résultat ? Un kaléidoscope linguistique, où l’on capte des bribes d’anglais, d’allemand, d’italien, et bien sûr, de vieux français. Les tireurs de pousse-pousse, figures discrètes mais omniprésentes, attrapent au vol ces mots, les transforment, les assemblent, et les font rouler dans la bouche des passants. La langue du pousse-pousse émerge alors, tissée de patois régionaux, d’idiomes d’ailleurs, et même de quelques restes de latin, vestige du prestige universitaire.
Voici quelques jalons historiques qui éclairent ce brassage unique :
- Robert de Sorbon fonde la Sorbonne pour accueillir les étudiants pauvres.
- Le Quartier latin accueille l’Université de Paris et devient un haut lieu d’échanges linguistiques.
- Paul Appell et André Honnorat initient au XXe siècle la Cité internationale universitaire, qui rassemble des étudiants de tous horizons.
Ce langage n’a jamais eu de frontières strictes. Il évolue au gré des générations, porté de bouche à oreille, s’enrichissant à chaque étape de la vie parisienne. Loin des leçons magistrales, la langue du pousse-pousse incarne le mouvement, la diversité et le génie collectif qui font vibrer la ville depuis des siècles.
Pourquoi cette langue intrigue-t-elle autant les linguistes et les voyageurs ?
Pourquoi la langue du pousse-pousse attire-t-elle autant la curiosité ? Pour les linguistes, elle représente un terrain d’observation inégalé, capable de révéler des siècles de rencontres, d’influences, de transmissions orales. Ce langage hybride, né au cœur du Quartier latin, capte tour à tour l’argot des étudiants, les mots d’emprunt venus de l’étranger, et les inventions locales. On y décèle des traces d’anglais, d’italien, d’Europe centrale, mais aussi l’empreinte du français académique bousculé par la vie de la rue.
L’essor de la Cité internationale universitaire de Paris au début du XXe siècle donne à ce phénomène une ampleur nouvelle. Chaque année, des étudiants de plus de 100 nationalités s’y côtoient, échangeant accents, expressions, et anecdotes. Ce va-et-vient linguistique rappelle d’ailleurs la trajectoire de figures comme Marie Curie, d’Irène Joliot-Curie ou d’Henri Bergson, qui ont fait de la Sorbonne et de l’École Normale Supérieure des carrefours d’idées et de mots venus d’ailleurs.
Pour les voyageurs, l’attrait est ailleurs. La langue du pousse-pousse offre une porte d’entrée vers un Paris méconnu, fait d’inventions langagières, de réparties inattendues, de mots qui collent à la ville comme une seconde peau. On y surprend parfois, au détour d’un trottoir, la gouaille d’un Jean-Paul Sartre préférant la rue aux salons huppés, ou la vivacité d’un dialogue glané sous les arcades de la Sorbonne.
Quelques faits marquants illustrent cet héritage foisonnant :
- Marie Curie, première femme professeure à la Sorbonne, a croisé des idiomes du monde entier.
- L’École Normale Supérieure compte 13 prix Nobel, dont Sartre et Bergson, témoins d’un rayonnement linguistique unique.
- La Cité internationale universitaire héberge aujourd’hui plus de 12 000 résidents venus de plus de cent pays.
Expressions insolites et anecdotes savoureuses à découvrir
La langue du pousse-pousse est un vivier d’expressions originales et d’histoires qui traversent le temps. Au xixe siècle, Balzac et Zola saisissent déjà, dans leurs romans, cette vivacité du parler parisien, où chaque tournure exprime l’inventivité du quartier. Le terme même de « pousse-pousse » s’échange parfois entre étudiants pour désigner l’entrain ou la débrouille, signe que l’argot universitaire n’est jamais loin du trottoir.
Certaines formules ont quitté la rue pour s’installer dans le quotidien. « Monter sa Sorbonne » illustre parfaitement ce phénomène : il s’agit de briller à l’oral, de défendre une idée avec panache, dans la pure tradition des débats universitaires. D’autres mots, plus confidentiels, rappellent la conquête de nouveaux droits. Prenons la loi du 21 décembre 1880, défendue par Camille Sée et Jules Ferry, qui ouvre l’enseignement secondaire aux jeunes filles : à la Sorbonne, la première génération de lauréates s’amuse à évoquer leur « bac en jupon », clin d’œil à ce bouleversement sociétal.
Des anecdotes témoignent de la créativité sans cesse renouvelée de cette langue. L’arrivée d’Anne Chopinet parmi les sept premières femmes admises à Polytechnique laisse une trace : ses camarades inventent un surnom en verlan, repris dans les amphis du boulevard Saint-Michel. Chaque mot, chaque histoire, façonne ainsi une cartographie mouvante, où le langage colle à la société, s’adapte, et se transmet comme un trésor vivant.
Quand la langue du pousse-pousse inspire l’art, la littérature et la vie quotidienne
La langue du pousse-pousse ne s’arrête pas aux frontières de l’université. Elle déborde dans les ateliers, les cafés, les galeries, nourrit peintres et poètes, s’invite dans les dialogues de romans et sur les murs lors des grandes heures de la Révolution française ou de la Commune. Les écrivains contemporains puisent avec gourmandise dans ce vocabulaire foisonnant, qui offre à chaque page une saveur inimitable.
L’influence de cette langue se mesure aussi à l’aune des grandes réformes. La Loi d’orientation du 12 novembre 1968 a éclaté l’antique Université de Paris en seize universités autonomes, dont Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et Paris 2 (Panthéon-Assas), réparties entre plusieurs académies. Ce redécoupage, scellé par le Décret du 21 mars 1970, a favorisé une circulation inédite des mots et une explosion des usages lexicaux.
Dans la vie courante, la langue du pousse-pousse se glisse partout : dans les amphithéâtres, les conversations de café, les affiches, ou encore les programmes de l’Université permanente de Paris, qui accueille aujourd’hui des seniors désireux de poursuivre leur formation. Les expressions nées sur les bancs de la Sorbonne se diffusent à Bordeaux, Strasbourg et bien au-delà, preuve que ce langage sans frontières continue de vivre, d’évoluer, et de raconter Paris autrement.
Un souffle traverse la ville, reliant les générations par des mots hérités, réinventés, partagés, une langue qui ne s’écrit jamais tout à fait, mais qui s’entend partout, dès qu’on tend l’oreille.